-
« Ce que fera une truie quand on la mène à la soue, on peut bien l’imaginer. Sauf qu’une bonne truie comme ça a la vie plus facile qu’un homme, c’est qu’elle est faite au vrai d’une espèce de chair et de graisse, et ce qui peut lui arriver par la suite c’est peu de chose, tant qu’elle a sa pâture : elle mettra bas encore, tout au plus, et au bout de sa vie il y a le couteau, ce qui au fond n’est pas non plus très grave ni très palpitant : avant qu’elle ait remarqué quoi que ce soit — et que peut bien remarquer une bête comme ça — elle est déjà crevée. Un homme en revanche, ça vous a des yeux, plein de choses là-dedans et tout mélangé ; il peut penser le diable et ne peut pas ne pas penser (terrible, sa tête) à ce qui lui arrivera. »
Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz
 votre commentaire
votre commentaire
-
 « Quand on m’aura tué à la guerre, je deviendrai une alouette. Parole », pense Petka. Dans l’immédiat, il élève clandestinement un louveteau dans la grange de ses grands-parents.
« Quand on m’aura tué à la guerre, je deviendrai une alouette. Parole », pense Petka. Dans l’immédiat, il élève clandestinement un louveteau dans la grange de ses grands-parents.On ne sait auquel des deux animaux ce petit garçon russe des années 1940 ressemble le plus. Il a la sauvagerie de l’un, sait se battre, mord ses adversaires au sang et se montre irrémédiablement rétif à toute contrainte. Mais il est toujours prêt à s’envoler dans des rêveries échevelées et son infatigable énergie fait de lui un être essentiellement vibrionnant, dominé tout entier par le démon de la vitesse : si une idée noire le trouble, c’est « l’affaire d’une seconde, à peu près l’instant qu’il faut à une toile d’araignée avec une araignée sautillant dessus pour glisser, par une journée venteuse et monotone proche de l’automne, sur une vitre et disparaître immédiatement sans laisser aucun souvenir » ; il court la steppe, « soulevant la poussière et criant des mots totalement incompréhensibles. Une minute plus tard, il ne rest[e] de lui qu’un point sombre à l’horizon, qui saut[e] et oscill[e] de droite à gauche comme une mouche ivre de joie, réveillée par la chaleur du soleil ».
En quête d’un père
Entre terre et ciel, réalisme et poésie, farce paysanne endiablée et sentiment russe du tragique, tout le livre d’Andreï Guelassimov semble se placer sous ce double totem de l’alouette et du loup. Il a pour cadre un village de Sibérie, région où l’auteur lui aussi est né (en 1965) et a commencé ses études. Les Bouriates et leurs chamanes ont déserté l’endroit, qu’ils estiment maudit. Mais les Russes, qui le peuplent, y ont installé un camp pour les Japonais faits prisonniers en 1939 lors de l’incident frontalier de Khalkhin Gol. Ces captifs meurent en quantité anormalement élevée dans la mine où ils travaillent et près de laquelle les fleurs présentent de bien étranges mutations. À la fin du roman, une bombe tombera sur Nagasaki.
Cependant la guerre, pas plus que l’écologie ou le totalitarisme, ne sont les vrais sujets d’un récit où ils ne constituent qu’une toile de fond pour ainsi dire naturelle. Certes, Petka rêve d’avoir pour père le camarade Staline mais, en somme, comme tout le monde. Surnommé par tout le village « fils de pute », ce petit héros habite avec sa très jeune mère, laquelle a été « traînée derrière les buissons » une dizaine d’années plus tôt par un voyou local à présent sous les armes. Le roman conte sa quête d’un véritable père. Celui des peuples n’étant, pour des raisons évidentes, pas disponible, le caporal Sokolov, le lieutenant chef Odinstsov, le commandant Balandine lui offriront successivement des solutions de remplacement. Car Petka est fasciné par l’Armée rouge et s’entraîne dans la grange « à saluer les chèvres de sa grand-mère », en observant, faute de miroir, son ombre. Pourtant, c’est en fin de compte un ennemi, le médecin militaire Hirotaro, qui constituera pour lui la plus convaincante incarnation de l’image paternelle.
Écriture des confins
Ce personnage, manière de vieux sage expert en herbes médicinales, est le second héros du récit, où les aventures de Petka alternent avec les pages du journal que le prisonnier destine à ses fils, convaincu qu’il est de ne pas les revoir (et ce sera le cas : ils vivent à Nagasaki). Mais on trouverait bien plus de deux livres au sein de ce roman qui, dans le huis clos paradoxal de la steppe immense et à partir d’un matériau de départ apparemment restreint, tresse de multiples fils narratifs, où viennent se lover mille histoires annexes qui tiennent parfois en quelques lignes. À travers ce cheminement capricieux, tout en parenthèses et retours en arrière, une progression insensible mais ultra-précise se dessine, qui rassemblera toutes les perspectives ouvertes en cours de route dans un superbe finale poético-mystique.
Entre-temps on aura vu se déployer le tableau d’un monde fascinant. Patriotisme et progressisme soviétiques y cohabitent sans problèmes avec superstitions et sorcellerie. Une violence extrême et générale y règne : tout le monde bat tout le monde, le sang coule à chaque page, la misère et la famine font des ravages. Mais tous, animaux et hommes, y paraissent possédés par le désir frénétique et jubilatoire d’être en vie. Et l’écriture d’Andreï Guelassimov, gonflée d’énergie et d’inventivité, servie par une belle traduction, mêlant, pour ce récit aux confins de l’Occident et de l’Orient, les tonalités et les cultures, rend ce désir communicatif.
P. A.
 votre commentaire
votre commentaire
-
« Alors ceux qui furent appelés se mirent debout hors du tombeau.
Avec la nuque, ils ont fait aller la terre en arrière ; du front, ils ont percé la terre comme quand la graine germe, poussant dehors sa pointe verte ; ils ont eu de nouveau un corps.
Il y avait un grand soleil ; une grande belle lumière est venue sur leurs mains, sur leurs habits, sur leurs chapeaux, sur leurs barbes, sur leurs moustaches. »
C. F. Ramuz, Joie dans le ciel
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Voilà un livre qui aurait pu beaucoup m’énerver : plus de quatre cents pages, longs remerciements à la fin, « playlist » au début, où s’égrènent les noms de personnes totalement inconnues de moi mais dont la seule mention est visiblement censée susciter les cris d’approbation de beaucoup d’autres… De façon générale, style jeune : la Canadienne Emily Schultz est, nous dit-on, « très active sur la scène littéraire et artistique émergente » ; il faut sans doute la considérer comme une écrivaine en voie de développement.
Voilà un livre qui aurait pu beaucoup m’énerver : plus de quatre cents pages, longs remerciements à la fin, « playlist » au début, où s’égrènent les noms de personnes totalement inconnues de moi mais dont la seule mention est visiblement censée susciter les cris d’approbation de beaucoup d’autres… De façon générale, style jeune : la Canadienne Emily Schultz est, nous dit-on, « très active sur la scène littéraire et artistique émergente » ; il faut sans doute la considérer comme une écrivaine en voie de développement.Ça commence comme ce qu’il faudrait sans doute appeler, pour rester dans le ton, « un truc girly » légèrement mâtiné de « trash », entre comédie sentimentale et roman de campus. Hazel Hayes est venue de Toronto à New York pour y rencontrer une directrice de thèse ; mais, résultat d’une liaison rapide avec son prof au Canada, elle se trouve enceinte ; comment va se débrouiller cette jeune femme d’aujourd’hui, entre désir d’avorter et restes de passion déçue ? On avance dans les premières pages avec une indulgence amusée en se demandant combien de temps on va tenir. Et puis on tient, et on se rend compte qu’on s’enfonce même avec un vrai plaisir dans ce gros roman aimablement foutraque.
Fable sociétale
Deux histoires s’y croisent et s’efforcent avec plus ou moins de bonheur de s’y mêler. La bluette contemporaine évoquée plus haut se complique en effet d’une intrigue de SF avec un grand F comme fantaisie : une épidémie peut-être répandue par les puces frappe soudain, sur toute la planète, les femmes blondes. Prises de rage, celles-ci sont capables par exemple de balancer sans sourciller une inconnue sous le métro ou de fracasser le crâne d’un cycliste innocent contre la rambarde d’un pont. « La Furie blonde affecte les femmes sans distinction de race, qu’elles aient les cheveux blonds naturels, peroxydés ou décolorés par des professionnels », faut-il préciser. On est donc clairement dans le conte philosophique ou, pour ceux qui préfèrent, la fable sociétale. Doctorante en « esthétologie », Hazel écrit « sur l’apparence des femmes et la manière dont on les perçoit » ; dans un monde où Hollywood et la publicité ont inventé le culte de « l’icône blonde », elle a compris que « les belles femmes sont habitées par une colère qui leur vient des avantages dont elles jouissent ».
Rousse, donc un peu à part et objet de méfiance à toutes fins utiles, elle se révèle une observatrice sagace de modes et de tics d’époque que l’auteure, en fin de compte, met en scène plus qu’elle n’y cède. Son héroïne, pour regagner leur Canada natal, traversera un pays sens dessus dessous, dans lequel des femmes au crâne rasé sont parquées dans de quasi-camps. Au terme de cette épopée un brin picaresque, elle échoue dans le chalet de son ancien amant, où, seule et bloquée par les neiges, elle lutte contre l’angoisse en racontant son histoire à l’enfant (une fille, forcément) qui grandit en elle.
« Donnez-moi la fessée… »
Réflexion sur le genre, protestation sociale, comique (entre farce rabelaisienne et humour noir), tragique s’entrecroisent dans un livre à la construction volontairement chaotique et qui a le charme du trop-plein. Mais ce qui fait qu’on s’y attache et qu’on suit jusqu’au bout le réjouissant méli-mélo qu’il propose, c’est le personnage principal. Emily Schultz sait imposer sa petite grosse pas très dégourdie mais qui, au moment crucial, n’hésite pas à déclarer à celui qu’elle veut séduire : « Allez-y. donnez-moi la fessée, professeur Mann ». Aussitôt dit, aussitôt fait — « Ma grosse croupe dessinait un arc au-dessus de ses maigres hanches. J’aimais ce que je voyais ». Après ce début torride mais prophétique, tous les malheurs du monde s’abattent sur Hazel avec une infaillibilité jubilatoire sans qu’elle perde ni son humour ni l’optimisme de son âge. Car les bons sentiments qui sont aussi le propre (d’une partie au moins) des jeunes générations finiront par s’imposer et par triompher, dans l’histoire de l’attendrissante rouquine comme dans le livre. Au fond, ils sont gentils, ces jeunes… Et Emily Schultz, une fois qu’elle aura émergé des naïvetés caractéristiques de son âge, deviendra sûrement la véritable écrivaine qu’elle est déjà.
P. A.
Illustration : Degas, Femme se peignant
 votre commentaire
votre commentaire
-
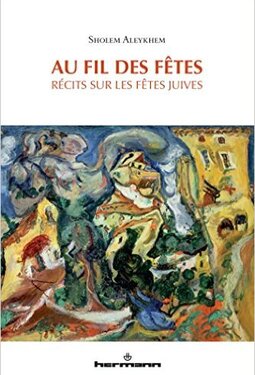 Sholem Aleykhem à la Maison de la Culture Yiddish
Sholem Aleykhem à la Maison de la Culture YiddishJ’ai parlé il y a quelques mois du recueil publié chez Hermann sous le titre d’Au fil des fêtes et rassemblant dix récits du grand écrivain yiddish, témoin et chantre d’un monde disparu qu’il élève à l’universel. Les deux traductrices, Doris Engel et Astrid Ruff, seront à Paris le samedi 19 novembre et présenteront le livre dont elles ont réalisé l’excellente version française ainsi que l’introduction et les notes.
Cela se passera à 15 heures, à la Maison de la Culture Yiddish, 29, rue du Château-d’Eau, 75010 Paris. Prix d’entrée 7 euros, 5 pour les adhérents.
Alain Blottière deux fois couronné
Le roman d’Alain Blottière, Comment Baptiste est mort (Gallimard), dont j’ai dit en juin
 dernier la forte impression qu’il m’avait faite, vient de recevoir coup sur coup le prix Décembre et le prix Giono. Juste récompense : l’auteur du Tombeau de Tommy y faisait de l’aventure tragique d’un adolescent enlevé par des djihadistes un superbe récit d’initiation.
dernier la forte impression qu’il m’avait faite, vient de recevoir coup sur coup le prix Décembre et le prix Giono. Juste récompense : l’auteur du Tombeau de Tommy y faisait de l’aventure tragique d’un adolescent enlevé par des djihadistes un superbe récit d’initiation.On me signale la vente de la collection d’Alfred de Vigny, dont ses manuscrits et sa correspondance, avec des lettres de ses amis : Victor Hugo, Balzac, Alexandre Dumas, Lamartine, Berlioz, Liszt…
Cela aura lieu le mardi 15 novembre à 14h30, chez Artcurial, 7, Rond-Point des Champs-Élysées, 75008 Paris.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...
 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot








