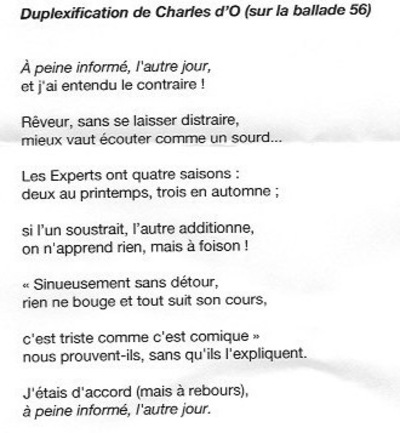-
En 2013, Jacques Jouet, écrivain et membre de l’OULIPO, lançait le PPP. C’est-à-dire le Projet poétique planétaire, dont l’idée, résume-t-il, est de « plaire au plus grand nombre, mais un par un ». Pour atteindre cet objectif, il a commencé à adresser, par voie postale, un poème à chaque membre de l’espèce humaine, en commençant (il faut bien commencer) par les habitants du département de l’Ain, ceux du moins qui figurent dans les pages blanches de l’annuaire, par ordre alphabétique de communes et de noms.
Quand la France sera faite, ce sera le tour du Gabon, puis de la Grèce, et ainsi de suite.
Notre homme avoue n’être pas sûr de voir achevée la tâche de son vivant. Mais d’autres, entre-temps, sont venus lui prêter main forte, et, parmi les premiers, Jean-Paul Honoré, que les lecteurs de ce blog connaissent déjà (voir ICI et ICI). Rien n’interdisant de déroger occasionnellement aux règles indiquées plus haut, l’auteur de Pontée m’a envoyé récemment, « en avance de quelques milliers d’années » sur mon tour, cette « Duplexification », tout à fait de saison, d’un poème de Charles d’Orléans, que je vous fais partager aujourd’hui.
Jean-Paul Honoré
Pour avoir plus de détails sur le PPP, voir, par exemple, ICI et ICI.
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Le Festin, Margaret Kennedy, traduit de l’anglais par Denise Van Moppès (Quai Voltaire)
Le Festin, Margaret Kennedy, traduit de l’anglais par Denise Van Moppès (Quai Voltaire)Une falaise s’effondre en Cornouailles. Certains sont ensevelis, d’autres sauvés. Margaret Kennedy, moraliste sans illusion, et portraitiste grinçante de l’Angleterre des années 1950…
Pour lire l’article, cliquez ici.
 La Stupeur, Aharon Appelfeld, traduit de l’hébreu par Valérie Zenatti (L’Olivier)
La Stupeur, Aharon Appelfeld, traduit de l’hébreu par Valérie Zenatti (L’Olivier)Dans son dernier roman, le grand écrivain israélien récemment disparu évoque une Bucovine étrange où coexistent la violence extrême et la grâce.
Pour lire l’article, cliquez ici.
 Les Yeux de travers, Guillaume Collet (Les Avrils)
Les Yeux de travers, Guillaume Collet (Les Avrils)Un homme arpente une ville, d’un petit boulot à l’autre. Ce premier roman dit la violence sociale à travers les sensations et par la syntaxe.
Pour lire l’article, cliquez ici.
 Les Silences d’Ogliano, Elena Piacentini (Actes Sud)
Les Silences d’Ogliano, Elena Piacentini (Actes Sud)Dans un pays méditerranéen trop imprécis pour qu’on y croie, deux jeunes gens vivent des aventures qui ressemblent à celles des héros de la collection « Signe de piste »…
Pour lire l’article, cliquez ici.
 Motl fils du chantre, Sholem-Aleikhem, traduit du yiddish par Nadia Déhan-Rotschild et Evelyne Grumberg (L’Antilope)
Motl fils du chantre, Sholem-Aleikhem, traduit du yiddish par Nadia Déhan-Rotschild et Evelyne Grumberg (L’Antilope)Pour les juifs ukrainiens qui rêvent de l’Amérique, le monde, en 1907, est bien dur. Mais le petit Motl raconte le malheur avec une verve désopilante et un talent étourdissant.
Pour lire l’article, cliquez ici.
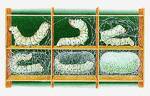 Cabane, Millie Duyé (Le Nouvel Attila)
Cabane, Millie Duyé (Le Nouvel Attila)Une fille construit des cabanes, au propre puis au figuré. Ce faisant, elle devient une femme. Un premier roman moderne et poétique.
Pour lire l’article, cliquez ici.
 Le Cœur d’un père, Josselin Guillois (Seuil)
Le Cœur d’un père, Josselin Guillois (Seuil)Le fils de Rembrandt parle, et raconte la vie près de son père, dans l’Amsterdam du siècle d’or. Un singulier roman d’éducation.
Pour lire l’article, cliquez ici.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Ma dernière pièce, Dis-moi qui tu hantes, a été jouée en mars dernier au Théâtre de l’Île-Saint-Louis, à Paris (voir ICI).
Pour ceux d’entre vous qui ne l’auraient pas vue ou, qui sait, voudraient la revoir, deux représentations auront lieu les 21 et 22 mai prochains à Strasbourg. Nous y jouerons dans la cave où Astrid Ruff et Pierre Kretz ont l’habitude d’accueillir des spectacles.
Vous trouverez tous les détails sur l’affichette ci-jointe.
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Pour son deuxième roman (après Louvre, Seuil, 2019), Josselin Guillois tente le mélange. Voici en effet un roman biographique (Rembrandt), qui est aussi, inévitablement, historique (Amsterdam au Siècle d’or), et articule une réflexion sur la peinture et la fonction sociale du peintre. C’est, en plus, voire surtout, un récit d’éducation.
Pour son deuxième roman (après Louvre, Seuil, 2019), Josselin Guillois tente le mélange. Voici en effet un roman biographique (Rembrandt), qui est aussi, inévitablement, historique (Amsterdam au Siècle d’or), et articule une réflexion sur la peinture et la fonction sociale du peintre. C’est, en plus, voire surtout, un récit d’éducation.Mélange intéressant en soi, et plus encore par son dosage. Peu de pittoresque d’époque : l’auteur résiste à la tentation du réalisme quotidien, auquel son sujet aurait pu l’inciter, comme aux pièges que lui tendait une cité mythique. À peine entrevoit-on quelques bas-fond, avec « pontons branlants », « relents de bois pourri », odeurs d’épices mêlées à celle des excréments que rachètent « un bon prix » les producteurs de fraises.
Peindre une table
Pour ce qui est de Rembrandt, malgré quelques retours sur son enfance et sa carrière, on le voit, pour l’essentiel, dans sa dernière période. L’heure de gloire est passée. Les notables qu’il portraiture ne se reconnaissent plus dans ses toiles ni dans « sa manière rugueuse et revêche ». Il est criblé de dettes, la garde de son fils Titus, 17 ans, va peut-être lui être retirée. Mais l’art de ce peintre en bout de course touche à son point le plus extrême et le plus intense. « Ce qui l’excite : des vieillards partout, des indigents, de la vieille chair, affaissée, boursouflée, avec des éruptions et des irritations cutanées, des plis, des rides ». Rien de lisse : la matière du corps. La matière tout court — « rehauts épais », « taches de couleur juxtaposées », « épais empâtements raboteux ». Il en fait de la lumière. Quand il peint une table, cette lumière en « jaillit, liquide », elle a « quelque chose de fangeux, elle brûle la pupille ». Le vieil artiste « ne sai[t] plus faire de la spiritualité que dans la pesanteur », et sa peinture est profondément charnelle, voire sexuelle. « Je vais me caresser, tandis que toi, tu peins ».
C’est Titus qui parle, comme il le fait tout au long du livre mis à part quelques passages à la troisième personne. En choisissant de nous faire partager la vision oblique, rapprochée et pourtant gauchie, que l’adolescent a de son père, Guillois ne donne pas seulement à son histoire de peintre une dimension supplémentaire d’initiation-éducation. Il la transforme, comme dit la quatrième de couverture, en « une histoire d’amour ».
Un étrange amour
Pas n’importe quel amour. Changeant sans vergogne, comme il l’avoue dans une note au lecteur, la réalité historique, notre auteur place le couple père-fils au vrai centre du roman. On est dans un monde d’hommes, et Madeleine, qui tient le ménage de Rembrandt et deviendra la maîtresse de Titus, demeure, malgré tout, un beau personnage secondaire. L’amour dont il s’agit ici est avant tout celui qui unit géniteurs et rejetons. Titus, fasciné, observe son génie de père, attendant en vain des signes d’affection de la part de celui que semble dévorer la peinture (« Si tu laissais l’atelier tranquille, juste pour cette nuit, et qu’on allait ensemble se reposer, une fois ? »). Mais il ignore que, chaque nuit, Rembrandt vient le regarder dormir. Le mythe d’Abraham et Isaac, relaté par un personnage dans une page très belle, est ici une fausse piste. Les pères et les fils sont dévorés par une passion réciproque, et le père du peintre, déjà, « s’enamoure de son bébé, le réveille la nuit pour l’embrasser (…), ne le laisse pas tranquille ». C’est une passion physique, non pas sexuelle, mais très charnelle, le corps vieilli du père croisant sans cesse la corps jeune du fils, tous deux se rejoignant dans le même lit. Josselin Guillois explore ces rapports singuliers jusqu’à les inverser. Ainsi Titus rêve d’une « espèce d’ourse très maternelle » vivant « à l’intérieur » de lui, et qui, quand Rembrandt descend de son atelier à l’aube, s’éveille pour « cueillir son ourson qui revient de cueillette ». « L’ourson, c’est toi, papa », précise-t-il.
Le fils Titus est enceint d’une bête qui est la mère dévoreuse de son père… Et Guillois, dans l’histoire du monstre Rembrandt, inclut une autre histoire, plus inhabituelle et heureusement dérangeante. Oh, bien sûr, ça ne va pas sans quelques tirades légèrement emphatiques. Notre auteur en fait souvent un tout petit peu trop (et puis on se demande pourquoi il éprouve le besoin, de temps à autre, de supprimer les négations). Pourtant, quand, à la fin de son roman, il montre, au mépris des faits, Rembrandt mourant dans les bras de Titus, on se dit qu’il a trouvé et dit, ce qui n’est pas rien, une manière nouvelle de tuer le père : par amour.
P. A.
Illustration : Rembrandt, Portrait de Titus, 1668
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Voici le premier roman d’une auteure qui n’a pas trente ans. Que raconte-t-il ? Une enfance ballotée entre père et mère, entre solitude et besoin d’intégrer, à l’école puis au lycée, des « tribus » ; la rencontre de « Lui », qui deviendra vite « Tu », quitté pour un autre, retrouvé ; les hauts, les bas d’une relation qui finira par faire naufrage.
Voici le premier roman d’une auteure qui n’a pas trente ans. Que raconte-t-il ? Une enfance ballotée entre père et mère, entre solitude et besoin d’intégrer, à l’école puis au lycée, des « tribus » ; la rencontre de « Lui », qui deviendra vite « Tu », quitté pour un autre, retrouvé ; les hauts, les bas d’une relation qui finira par faire naufrage.Bref, en soi, pas grand-chose. On s’en doute, tout ici sera, plus que jamais, dans la manière de raconter. Peut-on pour autant parler de maniérisme ? Pas vraiment. En face de son histoire banale, celle qui parle construit autre chose, une vaste allusion, derrière laquelle le lecteur distinguera les étapes que j’ai grossièrement énumérées. Ce faisant, elle se construit elle-même. On n’est donc pas dans le décoratif ou le brio gratuit : à mesure que le roman se développe, nous assistons, comme en une sorte de performance littéraire, à une action.
« Tête la première… »
Que construit la narratrice-héroïne de Millie Duyé ? Des cabanes, bien sûr. C’est-à-dire, pour être plus précis, l’histoire d’une fille qui construit des cabanes. D’abord pour de bon, ces cabanes de draps ou de branchages que les enfants bâtissent et que leur imagination métamorphose : « Comme dans un film d’espionnage, un passage s’ouvre automatiquement à mon approche : une trappe au centre du tronc, j’y engouffre tout mon corps, tête la première et me laisse glisser le long d’un toboggan. J’atterris en zigzaguant sur mon lit ». La cabane-maison devient un « bateau-lit » qui cingle vers les rivages de la préadolescence. Bientôt, c’est la relation avec l’autre qui est édifice et refuge (« Mon amour pour toi est une maison »).
Passant progressivement de l’enfance à l’âge adulte, on glisse du propre au figuré, et on parcourt ainsi tout l’espace de la métaphore, autrement dit, d’une certaine façon, de la littérature. En chemin, notre auteure décline les différentes acceptions possibles du mot cabane (y compris « case où les vers à soie filent leur cocon ») et du verbe cabaner (sans oublier « mettre une embarcation quille en l’air pour la réparer »). Selon une technique que l’OULIPO n’aurait pas reniée, le mot fonctionne ici comme moteur et comme programme.
« Notre cocon dans un coton… »
On peut le dire autrement : il s’agit ici de conserver la vision enfantine au-delà de l’enfance, et d’appliquer le point de vue de l’enfant aux péripéties de la vie adulte. À mesure que le livre avance, cependant, tout évolue et se transforme. D’une cabane à l’autre, on s’élève peu à peu suivant une progression en spirale rythmée par le retour de certains motifs : le symbole chinois des trois singes, une histoire d’ancre miniature avalée, le thème de la navigation, celui de l’animalité… Progression scandée aussi par le retour, plutôt que d’images, de formules, dans ce texte où sonorités et jeu avec les mots tiennent une place essentielle : « Dans ma cabane, j’ai deux cent deux doudous » ; « On file notre cocon dans un coton laiteux » ; « Mon père n’est pas simplement pratique, il ne fait pas que pratiquer, il pratique des choses pratiques, il est pratico-pratique »… Les virgules, dans tout ça, semblent saupoudrées au petit bonheur. Cependant notre adroite auteure réussit à s’assurer le bénéfice du doute : c’est sûrement, dans sa partition musicale et heurtée, un effet de rythme…
Qu’est-ce qui, en fin de parcours, émerge de cet étrange labyrinthe fait de cabanes empilées ? Une femme, bien sûr, dont on nous a raconté l’avènement. Car, cela a été indiqué à plusieurs reprises, elle était elle-même ces édifices successifs à l’abri desquels, « absente à l’extérieur (…), mais trop présente à [elle]-même », elle cherchait à se protéger du monde. À la fin, elle le dit, « [ses] murs s’effritent ». Et Millie Duyé, de cabane en cabane, a renouvelé, de manière moderne, drôle et radicalement poétique, le vieux récit de formation.
P. A.
 votre commentaire
votre commentaire
Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...
 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot